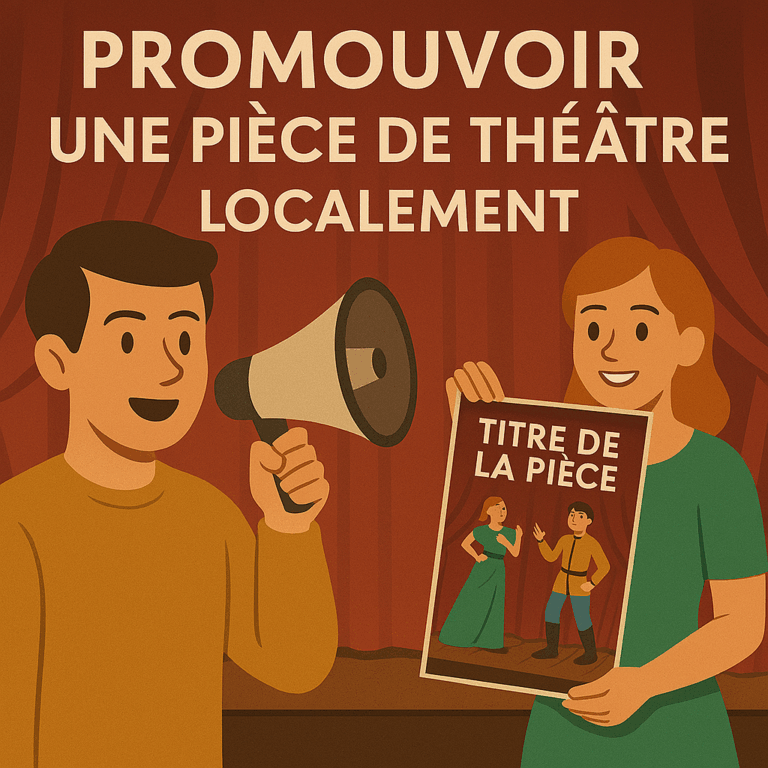Le costume breton sur scène : entre authenticité et stylisation
ERIC FERNANDEZ LEGER
Coiffes, broderies et symbolique des territoires
Résumé
Cet article examine les processus de patrimonialisation et de spectacularisation du costume breton traditionnel depuis son abandon comme vêtement quotidien au milieu du XXe siècle jusqu’à ses usages contemporains sur les scènes festives et compétitives. À travers l’étude des coiffes, des broderies et de la symbolique territoriale, nous analysons la tension permanente entre la quête d’authenticité historique et les nécessités de la stylisation scénique. Mobilisant un cadre théorique empruntant à l’ethnologie du vêtement, aux heritage studies et à la sociologie de la performance, l’article démontre que la scène ne constitue pas une dénaturation du costume mais un nouveau régime de signification où l’identité territoriale est performée plutôt que vécue. L’étude s’appuie sur des sources archivistiques, des enquêtes de terrain dans des cercles celtiques, des entretiens semi-directifs avec des acteurs de la transmission et une analyse iconographique.
Introduction
« I am Breton, and I am French, but I am Bigouden first » : cette déclaration d’une jeune danseuse du cercle celtique de Pont-l’Abbé à une journaliste de National Geographic en 2015 résume avec une acuité remarquable l’enjeu identitaire que porte le costume traditionnel en Bretagne contemporaine [Fiegl, 2015]. Alors que le port quotidien de ces vêtements a disparu depuis plusieurs décennies — les hommes ayant abandonné les premiers les formes anciennes dès la fin du XIXe siècle, les femmes ne conservant la coiffe que jusqu’au milieu du XXe siècle avant de céder à leur tour aux modes citadines —, le costume continue d’incarner une appartenance territoriale et culturelle d’une vigueur surprenante.
Cette persistence d’un objet vestimentaire après la disparition de son usage premier interroge fondamentalement les sciences sociales. Que devient un vêtement lorsque sa fonction première — protéger le corps, signifier un statut social dans l’interaction ordinaire — s’efface au profit d’une fonction spectaculaire ? Comment analyser les processus par lesquels des objets issus de la vie quotidienne se trouvent transférés vers des espaces de représentation ? Quelles négociations s’opèrent entre la volonté de fidélité historique et les impératifs esthétiques et pratiques de ces nouveaux contextes ?
L’historien Patrick Young a magistralement analysé comment, entre 1890 et 1937, le costume breton est progressivement passé du statut de marqueur ethnographique à celui d’élément d’un patrimoine consommable et performé [Young, 2009]. Cette « patrimonialisation » n’a pas été sans soulever « des questions délicates d’identité culturelle et d’authenticité ». Les festivals nouveaux, comme les pardons réinventés ou les concours de cercles celtiques, ont fait du costume « un médium d’échange plus fluide — un médium à travers lequel Bretons et non-Bretons pouvaient symboliquement jouer leurs expériences conflictuelles de continuité et de changement culturels » [Young, 2009, p. 634].
Il convient d’emblée de souligner le paradoxe chronologique sur lequel repose cette étude : les symboles les plus puissants de la Bretagne dite « immémoriale » — la coiffe bigoudène, le chapeau rond, les costumes de cérémonie — sont en réalité des créations relativement récentes. Comme le rappelle l’historien Erwan Chartier, ils remontent pour la plupart au début du XIXe siècle et n’ont cessé d’évoluer jusqu’à leur abandon progressif dans la seconde moitié du XXe siècle. Cette historicité du « traditionnel » constitue le premier indice que l’opposition binaire entre authenticité et stylisation mérite d’être complexifiée.
Notre propos s’articulera autour de trois entrées qui structurent la visibilité contemporaine du costume breton : la coiffe, élément emblématique entre tous ; la broderie, support d’une créativité technique et symbolique ; et la territorialité, qui fait du costume un système de signes géographiquement codifié. Pour chacune, nous interrogerons les négociations entre authenticité et stylisation qui s’opèrent dans le passage à la scène.
Cadre théorique
Notre analyse mobilise trois cadres théoriques principaux. Le premier est celui des performance studies, tel que développé par Richard Schechner [2002] et Victor Turner [1982]. La scène des festivals bretons constitue un espace liminal où les identités sont temporairement suspendues, réagencées et réaffirmées. Le port du costume y relève d’une « performance » au sens fort : il ne s’agit pas simplement de se vêtir, mais de donner à voir, d’incarner un rôle collectif devant un public. La notion de restored behavior (comportement restauré) proposée par Schechner est ici particulièrement heuristique : les danseurs des cercles celtiques ne reproduisent pas mécaniquement des gestes ancestraux, mais les re-créent à partir de sources multiples dans un cadre qui est celui de la représentation.
Le second cadre est celui des material culture studies, notamment dans la lignée des travaux de Daniel Miller [2010] sur la culture matérielle et l’identité. Miller a montré comment les objets, loin d’être de simples reflets passifs des identités sociales, participent activement à leur construction. Le costume breton sur scène n’est pas un simple signifiant d’une identité préexistante : il contribue à produire et à stabiliser cette identité, à la rendre tangible et visible.
Le troisième cadre est celui de l’anthropologie du patrimoine, représentée par les travaux de Regina Bendix [1997] sur la quête d’authenticité dans les sociétés contemporaines. Bendix a montré comment l’authenticité, loin d’être une propriété objective des objets ou des pratiques, est une construction sociale et culturelle, constamment négociée et réinventée. Cette approche nous permet d’éviter les écueils d’une opposition trop simple entre un passé « authentique » et un présent « inauthentique », pour nous intéresser aux processus par lesquels certains acteurs attribuent ou contestent la qualité d’authenticité.
Méthodologie
Notre recherche s’appuie sur un corpus diversifié et une méthodologie mixte. Nous avons consulté les collections du Musée départemental breton à Quimper, qui conserve plus de 12 000 pièces de costume traditionnel, ainsi que les fonds photographiques des Archives départementales du Finistère documentant le port du costume entre 1850 et 1950.
Une enquête de terrain a été menée au sein de trois cercles celtiques de la fédération Kenleur (cercle de Pont-l’Abbé, cercle de Quimper, cercle de Brest) entre 2023 et 2025. Cette immersion nous a permis d’assister aux répétitions, aux ateliers de confection des costumes, ainsi qu’aux prestations scéniques lors de festivals. Vingt-trois entretiens semi-directifs ont été réalisés avec des acteurs diversifiés : responsables de cercles celtiques, brodeurs et brodeuses professionnels ou amateurs, danseurs et danseuses de différentes générations, conservateurs de musée. Enfin, un corpus de 250 images (photographies d’archives, cartes postales, catalogues commerciaux, photographies contemporaines de spectacles) a été constitué et analysé.
Partie 1. La coiffe : de la carte d’identité à l’objet spectaculaire
La coiffe bretonne constitue sans doute l’élément le plus emblématique du costume traditionnel. Sa spectacularisation sur scène offre un cas d’école pour analyser les transformations du vêtement en costume de représentation.
1.1. Morphologie et fonction identificatoire
Dans son usage quotidien, la coiffe remplissait une fonction analogue à celle d’une « carte d’identité », comme le rappellent tant Solenn Boennec, conservatrice adjointe du Musée bigouden, que le spécialiste Yann Guesdon [2014]. Elle pouvait révéler qui vous étiez, d’où vous veniez, et si vous étiez en deuil. Cette fonction identificatoire était poussée à un degré de précision remarquable : l’ethnologue René-Yves Creston [1953] en répertorie précisément 66 « modes » distinctes dans toute la péninsule, tandis que les inventaires contemporains évoquent plus de 400 variantes locales si l’on tient compte des nuances subtiles.
L’analyse morphologique proposée par Guesdon [2014, 2019] distingue plusieurs éléments constitutifs de la coiffe : le fond qui recouvre le sommet du crâne, la visagière qui encadre le visage, les ailes qui couvrent les épaules et le bavolet qui protège la nuque. La combinaison de ces éléments, leur forme, leur hauteur, leur degré d’ouverture, constituaient un véritable code visuel, immédiatement lisible par les contemporains.
Cette diversité répondait à un besoin de distinction territoriale exacerbé après la Révolution française. L’abolition des lois somptuaires en 1792 permit au tiers état d’accéder à des matières jusque-là réservées. Selon Erwan Vallerie, « à l’obsession paranoïaque de l’uniformité républicaine répondit une obsession réflexe de la singularité » [Vallerie, 1995, p. 78]. Chaque village, chaque bourg mit un point d’honneur à se distinguer du voisin par la forme de ses coiffes.
Il convient toutefois de nuancer l’idée d’une correspondance stricte et immuable entre coiffe et localité. Roger Huiban, fin connaisseur de la culture bretonne, souligne qu’il n’était pas rare que certaines femmes portent le costume et la coiffe du terroir voisin car il était plus prestigieux, pratique mal vue qui les obligeait à dissimuler leur origine véritable [Le Télégramme, 2007]. Cette pratique, attestée dès le XIXe siècle, montre que la coiffe n’était pas un marqueur figé mais un signe en constante négociation, déjà sujet à des phénomènes de mode et de distinction sociale.
1.2. Genèse et évolution
L’histoire de la coiffe bretonne ne se réduit pas à une évolution linéaire vers une spectacularisation croissante. Du Moyen Âge au XVIIe siècle, la coiffe était avant tout fonctionnelle, portée dans toute la France. En Bretagne, sa fonction première était double : se protéger des intempéries et, comme le souligne Yann Guesdon, cacher les attributs féminins pour empêcher toute séduction, les cheveux étant alors considérés comme « les allumettes du diable » [Guesdon, 2014, p. 15].
L’évolution vers des formes plus élaborées et plus hautes s’amorce au cours du XIXe siècle, sous l’influence conjuguée de plusieurs facteurs. L’arrivée de nouvelles matières — tulle, dentelle industrielle — permet des réalisations plus légères et plus ouvragées. L’élévation du niveau de vie dans certaines zones, notamment dans le pays bigouden grâce à la prospérité de l’industrie sardinière, autorise des dépenses vestimentaires plus importantes. Enfin, la compétition sociale entre villages et entre familles joue un rôle moteur dans cette course à la hauteur.
Le cas de la coiffe bigoudène est emblématique de ce processus. À l’origine simple bonnet de coton ou de lin, elle s’est progressivement élevée pour atteindre des hauteurs spectaculaires — jusqu’à 33 centimètres pour les modèles de cérémonie. Une légende tenace attribue cette élévation à une protestation contre l’abaissement des clochers des églises par les troupes de Louis XIV après la révolte des Bonnets rouges en 1675. En réalité, comme le note l’Abécédaire de la mode bretonne, la coiffe bigoudène semble être apparue à la fin du XVIIIe siècle — la première représentation figure dans le Voyage dans le Finistère de Jacques Cambry en 1798 — et elle a vraiment pris de la hauteur un siècle plus tard, et ce jusque dans les années 1980 [Faligot, 2022].
Cette « tour de force » (littéralement « tour de dentelle ») est devenue l’emblème visuel de la Bigoudénité, au point d’être reprise par les artistes dès la fin du XIXe siècle : Paul Gauguin, lors de ses séjours à Pont-Aven, s’en empare comme motif pictural, tandis que les photographes comme Charles Fréger en font au XXIe siècle l’objet d’une exploration esthétique systématique.
1.3. La coiffe sur scène : adaptations techniques et transformations esthétiques
Le passage à la scène impose aux coiffes des adaptations techniques et esthétiques significatives. Les contraintes sont multiples : visibilité depuis le fond des grandes salles ou des scènes en plein air, tenue dans le mouvement rapide de la danse, résistance à la transpiration et aux intempéries, facilité d’enfilage et de retrait lors des changements de costume.
Notre enquête de terrain auprès des cercles celtiques permet de documenter ces adaptations. Les coiffes de spectacle sont généralement plus rigides que leurs modèles historiques, grâce à un amidonnage plus prononcé ou à l’incorporation de renforts plastiques discrets. Leurs proportions sont souvent amplifiées, les contrastes chromatiques accentués. Certains détails, trop fins pour être visibles à distance, peuvent être simplifiés ou agrandis.
Ces transformations ne vont pas sans susciter des débats au sein des cercles. Lors des concours organisés par la fédération Kenleur, les jurys évaluent la conformité des costumes aux canons historiques du terroir représenté. Une coiffe trop haute ou trop stylisée peut être pénalisée. Mais en même temps, la nécessité de « faire de l’effet » sur scène, de se démarquer des autres cercles, pousse à des innovations mesurées.
Le témoignage d’une responsable du cercle de Pont-l’Abbé est éclairant : « On travaille à partir de photos anciennes, de pièces conservées au musée. On essaie d’être le plus fidèle possible. Mais on sait bien que ce n’est pas pareil : nos danseuses ne portent pas la coiffe tous les jours, elles n’ont pas le même geste, la même habitude. Et puis il faut que ça rende bien sur scène, que ça se voie de loin. Donc on adapte un peu, on accentue certaines choses. C’est un équilibre à trouver » (entretien, 12 mars 2024).
1.4. Des dernières porteuses aux nouvelles générations
La comparaison entre les dernières porteuses quotidiennes et les jeunes générations des cercles celtiques fait apparaître un changement profond dans le rapport à la coiffe. Alexia Caoudal, 87 ans, et Marie-Louise Lopéré, 90 ans, font partie des rares femmes à porter encore régulièrement la coiffe bigoudène dans la vie courante [Fiegl, 2015]. Le geste qu’elles accomplissent chaque matin — tirer, peigner et épingler leurs nattes sous un bonnet noir spécial, avant d’ajouter le dessus en dentelle le dimanche et pour les occasions spéciales — relève d’un savoir-faire incorporé, d’une routine qui prend près d’une demi-heure. Il faut ajouter à cela le temps de l’entretien : les coiffes de cérémonie, en dentelle fine, nécessitaient un amidonnage régulier et un repassage méticuleux.
À l’inverse, Apolline Kersaudy, 20 ans, membre du cercle celtique de Pont-l’Abbé, explique avoir rejoint son cercle à l’âge de six ans, sacrifiant ses vacances d’été à l’entraînement : « Les autres amis ne comprennent pas pourquoi nous ne pouvons pas partir en vacances d’été avec eux. Mais le cercle est plus important » [Fiegl, 2015]. Ce dévouement atteste d’un investissement identitaire fort, mais qui s’exerce désormais dans le cadre de la représentation.
L’exemple de la « Marmotte », coiffe typique de Brest et de sa région, illustre ce passage de l’obligation à la coquetterie, puis à la patrimonialisation. D’allure relativement simple comparée aux coiffes bigoudènes, elle était portée par les artisanes et les citadines. La plus ancienne Marmotte connue date de 1850 [De Saint Jan, 2015]. Son évolution montre l’arrivée progressive d’ornements : avec l’importation du tulle, les broderies et autres fantaisies sont apparues, le bavolet a disparu, la visagière a laissé apparaître les cheveux. « La coiffe devient une coquetterie, un atout pour séduire », note Yann Guesdon. Délaissée à partir de 1920, elle marque « la fin d’une mode, un phénomène urbain qui suivra dans les campagnes » [cité dans De Saint Jan, 2015].
Partie 2. La broderie : entre tradition technique et création contemporaine
La broderie constitue le second pilier de l’ornementation du costume breton. Inscrite depuis 2021 à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel en France, elle connaît aujourd’hui un regain d’intérêt qui interroge les frontières entre reproduction à l’identique et innovation créative.
2.1. Histoire et technique : l’âge d’or de la broderie bretonne
L’histoire de la broderie bretonne est indissociable de celle du costume lui-même. Les plus anciennes pièces conservées dans les collections muséales — un porpant (veste) de 1811 et un gilet bigouden de 1814 — témoignent déjà d’une maîtrise technique accomplie. Le porpant, conservé au Musée départemental breton, est orné de palmettes et d’un Sacré-Cœur sur la poitrine ainsi que de « dents de loup » sur les manches et sous les emmanchures. Le gilet bigouden présente quant à lui un double plastron décoré de palmettes et de fleurons néoclassiques multicolores.
L’âge d’or de la broderie se situe entre 1850 et 1914. Cette période voit l’émergence d’une ornementation riche et variée, distincte d’un terroir à l’autre. Deux types de brodeurs coexistent alors : les brodeurs citadins, qui ont accès aux journaux de modes parisiens et en importent les motifs, et les brodeurs de pleine campagne, qui conservent plus longtemps des motifs anciens et développent des répertoires spécifiques à leur terroir. Ce sont ces derniers qui « feront naître cette broderie qui s’épanouira dans le sud de la Basse-Bretagne » [Jouanic & Hélias, 1996, p. 23].
L’arrivée de nouvelles étoffes et matières, rendues accessibles par le développement des industries textiles lors de la Révolution industrielle et le commerce des colporteurs, a stimulé cette créativité. Les colporteurs lyonnais, en particulier, ont diffusé dans les campagnes bretonnes des étoffes et des rubans qui ont enrichi le vocabulaire ornemental local [Creston, 1953]. Rubans, mousseline, tulle et dentelle sont devenus abordables, cette dernière constituant même une source de revenus complémentaires dans plusieurs pays bretons, notamment sur le littoral cornouaillais.
L’inventaire des techniques de broderie témoigne de cette richesse. Parmi les plus usitées, les sources mentionnent les points hanter regenn (« demi-rang »), kamm (« courbe », « tordu »), drein pesk (« arête de poisson »), ou encore le point laouig, du nom de son hypothétique créateur Laouig Jegou, célèbre brodeur bigouden [Cario & Hélias, 2012].
2.2. Grammaire ornementale et symbolique des motifs
La broderie bretonne ne se réduit pas à une fonction décorative : elle porte un vocabulaire symbolique riche. Les motifs bigoudens, parmi les plus réputés pour leur finesse, illustrent cette dimension signifiante. On peut distinguer plusieurs catégories de motifs selon leur inspiration et leur signification.
Les motifs cosmiques, tels que le soleil, les étoiles ou la lune, symbolisent la joie, la lumière et le cycle de la vie. Ils apparaissent fréquemment sur les plastrons masculins. Les motifs végétaux — fougère, palmettes, fleurs diverses — évoquent la fécondité et la croissance ; ils ornent abondamment les vêtements féminins. Les motifs animaux, comme la corne de bélier ou les dents de loup, renvoient à la force et à la protection ; ils sont souvent spécifiques à certains terroirs. Les motifs géométriques, notamment la chaîne de vie ou les entrelacs, symbolisent l’éternité et la continuité ; on les trouve sur l’ensemble du territoire breton. Enfin, les motifs religieux — cœur, croix, calice — expriment la foi et l’amour divin, principalement sur les vêtements de cérémonie.
Cette grammaire ornementale n’est pas figée. L’analyse diachronique des collections montre des évolutions significatives : l’introduction de motifs exogènes par les journaux de mode, l’abandon progressif de certains motifs jugés désuets, l’invention de nouvelles combinaisons. La broderie bretonne est une tradition vivante, constamment réinventée, bien avant son transfert sur la scène contemporaine.
2.3. La transmission contemporaine
Le déclin du port quotidien du costume après 1950 a menacé la transmission de ces savoir-faire. Mais un regain d’intérêt s’est manifesté dès la fin du XXe siècle, porté par des artistes professionnels et amateurs qui se forment aux anciennes techniques.
Plusieurs figures émergent dans ce paysage de la transmission. Marc Le Berre, figure tutélaire de la renaissance de la broderie dans les années 1970-1980, a formé toute une génération de brodeurs. Pascal Jaouen, qui a fondé l’École de broderie d’art de Quimper en 1997, incarne la volonté de perpétuer les techniques traditionnelles tout en les ouvrant à la création contemporaine. Son école accueille chaque année des centaines d’élèves, venus de toute la Bretagne et parfois d’ailleurs, pour des stages allant de l’initiation au perfectionnement.
L’entreprise Le Minor, créée en 1936 par Marie-Anne Le Minor à Pont-l’Abbé, maintient quant à elle une production qui associe tradition et création. Initialement spécialisée dans la broderie sur costume traditionnel, elle a su évoluer vers la création de linge de maison et d’articles de mode brodés, collaborant avec des artistes renommés comme Mathurin Méheut, Dom Robert ou Pierre Toulhoat. Le catalogue des années 1950-1960, aujourd’hui conservé aux Archives départementales du Finistère, témoigne de cette transition entre production artisanale et industrialisation du motif breton.
Mais le lieu principal de transmission est aujourd’hui constitué par les associations et les cercles celtiques. Chaque cercle important dispose d’un atelier de couture et de broderie où les membres, souvent des femmes, confectionnent et entretiennent les costumes. Ces ateliers sont des espaces de transmission intergénérationnelle : les plus anciennes transmettent leur savoir-faire aux plus jeunes, dans une ambiance à la fois studieuse et conviviale. Notre observation participante dans l’atelier du cercle de Quimper a permis de documenter ces moments d’apprentissage, où se mêlent conseils techniques, récits d’expérience et discussions sur l’authenticité des motifs.
2.4. La création contemporaine : Mathilde Vaillant
Le cas de l’artiste Mathilde Vaillant, née en 1995, illustre les potentialités créatives qui émergent de cette double appartenance — à la tradition des cercles celtiques et au champ de la création plastique contemporaine.
Danseuse au sein d’un cercle de la fédération Kenleur, Mathilde Vaillant alterne la fabrication de coiffes traditionnelles avec une recherche plastique en broderie qui, nourrie du savoir-faire des brodeuses, offre un renouvellement des formes et des formats. Son travail puise son inspiration dans la culture bretonne tout en diversifiant ses supports et ses techniques. Le grand tressage en macramé, par exemple, renouvelle les motifs traditionnels du Trégor et offre un gros plan sur les techniques de broderie, tandis que l’aspect plastique, coloré et la douce odeur de foin proviennent du support, des filets de ballots de paille, récoltés, nettoyés et démêlés par ses soins.
Cette démarche est traversée par une conscience aiguë des enjeux de la folklorisation. Dans un entretien accordé en 2024, Mathilde Vaillant observe que si la folklorisation de la Bretagne a aujourd’hui évolué vers une utilisation marketing des symboles — dessins celtiques, cirés jaunes et coiffes bigoudènes —, la diversité des pratiques et des savoirs, notamment dans les travaux textiles, offre un énorme potentiel de création. Elle ajoute : « Mon travail, c’est une manière de dire qu’on peut être dans la tradition sans être passéiste, qu’on peut inventer à partir des techniques anciennes, leur donner une vie nouvelle » (entretien, 15 juin 2024).
Cette position est significative d’une nouvelle génération qui refuse l’alternative entre reproduction à l’identique et abandon pur et simple. Pour ces jeunes créateurs, l’authenticité n’est pas dans la fidélité littérale aux modèles anciens, mais dans la continuité d’une démarche créative — celle qui a toujours animé les brodeurs et brodeuses de Bretagne, constamment ouverts aux influences extérieures et aux innovations techniques.
Partie 3. La symbolique des territoires : un système de signes en représentation
La troisième dimension du costume breton que nous souhaitons interroger est sa fonction de marqueur territorial. Cette fonction, qui était implicite dans l’usage quotidien, devient explicite et performée dans le cadre de la scène.
3.1. Des costumes, pas un costume
Un lieu commun de la littérature ethnographique sur la Bretagne consiste à rappeler qu’il n’existe pas « un » costume breton mais « des » costumes bretons. Les Archives départementales du Finistère insistent sur ce point : en fonction du lieu, de l’époque, et même des situations, on ne porte pas le même costume, et c’est ce qui fait sa richesse et sa diversité.
Cette diversité s’organise selon plusieurs axes. Le premier est celui du genre : les vêtements masculins et féminins diffèrent non seulement par leur forme — les femmes portent des jupes, les hommes des bragou ou pantalons — mais aussi par leur couleur et leur dénomination. Dans la région de Quimper, on parle ainsi des femmes borledenn et des hommes glazig, les premières portant des coiffes à large bord, les seconds étant vêtus de vestes bleues (glaz en breton).
Le second axe est celui de l’usage : on distingue traditionnellement les vêtements de travail, les vêtements du dimanche et les vêtements de cérémonie. Ce sont ces deux dernières catégories qui symbolisent aujourd’hui le mieux le costume breton, les vêtements de travail ayant disparu avec l’activité agricole et artisanale qui leur donnait sens.
Le troisième axe, le plus finement discriminant, est celui de la localité. Chaque village, et parfois chaque quartier de ville, développait ses particularités. On dénombre plus de 65 modèles sur l’ensemble de la péninsule armoricaine à la fin du XIXe siècle [Creston, 1953], avec des dominantes chromatiques qui fonctionnaient comme des signatures visuelles. Les Quimpérois s’habillaient dans les tons bleus, les habitants du pays d’Elliant portaient des costumes à dominante jaune — d’où leur surnom de Melenig, les « petits jaunes » —, ceux de Châteaulin des costumes à dominante rouge, les Rouzig.
Un proverbe breton résume cette extrême fragmentation : « Kant bro, kant iliz, kant giz » (Cent pays, cent églises, cent modes). Cette identification si forte entre un groupe humain et sa parure vestimentaire est sans doute unique en France et témoigne de la puissance du costume comme opérateur identitaire.
Roger Huiban explique cette géographie variable des modes par la présence d’obstacles naturels : les aires des modes spécifiques se fractionnent selon la présence d’obstacles géographiques comme les rivières ou les montagnes. Là où il n’y a pas de frontières naturelles, il existe une variété étonnante de costumes et de coiffes [Le Télégramme, 2007].
3.2. La scène comme espace de reterritorialisation
Le passage à la scène opère une transformation paradoxale de cette territorialité. D’un côté, il tend à gommer les distinctions les plus fines au profit de catégories plus larges et plus reconnaissables — le « bigouden », le « glazig », le « plougastel » fonctionnent comme des marqueurs génériques. De l’autre côté, il réactive et même renforce la dimension identificatoire du costume, mais sur un mode symbolique plutôt que pratique.
Les concours de cercles celtiques, qui se déroulent dans le cadre des grands festivals bretons, illustrent cette dynamique. Les groupes y présentent des costumes qui se veulent fidèles à un terroir spécifique, et leur prestation est évaluée notamment sur la conformité de leur tenue aux canons historiques de ce terroir. La scène devient ainsi l’espace d’une reterritorialisation paradoxale : c’est en se montrant, en se donnant à voir sur une scène souvent éloignée de leur lieu d’origine, que les danseurs affirment leur appartenance à un territoire précis.
Notre analyse des grilles d’évaluation utilisées par la fédération Kenleur lors des concours montre que le costume compte pour une part significative de la note, environ 30 %. Les critères incluent la conformité historique — fidélité aux modèles du terroir pour la période de référence —, la qualité de réalisation des broderies et des finitions, l’adéquation à la danse en termes de confort et de tenue dans le mouvement, et l’harmonie d’ensemble du groupe. Ces critères cristallisent les tensions entre exigence d’authenticité et nécessités scéniques.
Le témoignage de Malwenn Mariel, 17 ans, membre du cercle celtique de Pont-l’Abbé, est éloquent : « I am Breton, and I am French, but I am Bigouden first » [Fiegl, 2015]. Cette déclaration atteste de la vigueur de l’identification territoriale chez les jeunes générations, mais aussi de sa transformation : l’identité bigoudène n’est plus vécue principalement dans l’interaction quotidienne avec d’autres Bigoudens, mais dans la représentation de cette bigoudénité devant un public élargi, y compris international.
3.3. Usages commerciaux et politiques du costume territorialisé
La puissance identificatoire du costume territorialisé n’a pas échappé aux acteurs économiques et politiques. Dès les années 1930, des établissements hôteliers et des conserveries utilisent l’image de la Bretonne en costume comme marqueur d’authenticité. Patrick Young [2009] a montré comment ces appropriations par des acteurs extérieurs au monde rural traditionnel ont contribué à redéfinir la valeur et la signification du vêtement.
L’exemple du restaurant Chez Mélanie à Riec-sur-Belon est particulièrement instructif. La patronne, Mélanie Rouat, imposait à ses serveuses le port de la coiffe, un exemple de la tradition vestimentaire du giz-fouen. En déclarant ainsi son identité bretonne, elle s’affranchissait des conventions vestimentaires du métier de la restauration. Cette promotion des traditions culturelles via l’uniforme des serveuses acquit une telle réputation dans l’industrie hôtelière que, dans les années 1950-1970, de jeunes femmes de Riec-sur-Belon venaient faire les saisons sur la Côte d’Émeraude, à plus de 150 kilomètres de chez elles, pour travailler dans des établissements qui recrutaient spécifiquement ce « type » authentique.
De même, les conserveries comme Amieux ou Cassegrain, en quête d’authenticité, utilisaient l’image de l’opulente cuisinière bretonne en costume traditionnel. Cette appropriation commerciale du costume territorialisé pose évidemment la question de l’authenticité : que reste-t-il de la fonction identificatoire originelle lorsque le costume devient un uniforme professionnel interchangeable, porté par des jeunes femmes loin de leur terroir d’origine ?
L’analyse de Young suggère que ces usages commerciaux, loin d’être de simples dévoiements, ont participé de la patrimonialisation du costume en le rendant visible et désirable pour un public élargi. Ils ont contribué à faire du costume « un médium d’échange plus fluide — un médium à travers lequel Bretons et non-Bretons pouvaient symboliquement jouer leurs expériences conflictuelles de continuité et de changement culturels » [Young, 2009, p. 634].
3.4. Authenticité et performance dans les concours
Les concours de cercles celtiques constituent un observatoire privilégié pour analyser les négociations entre authenticité et stylisation. Notre observation de trois éditions du championnat de Bretagne de danses traditionnelles (2022-2024) permet de dégager plusieurs tendances.
Premièrement, on observe une professionnalisation croissante de la préparation. Les cercles les plus compétitifs consacrent des budgets importants à la confection de costumes, font appel à des brodeurs professionnels, consultent des archives et des spécialistes. La recherche d’authenticité devient un investissement, un facteur de distinction dans la compétition.
Deuxièmement, cette quête d’authenticité s’accompagne paradoxalement d’une stylisation accrue. Les costumes de concours sont souvent plus « typés », plus spectaculaires que ne l’étaient les vêtements quotidiens. Les couleurs sont plus vives, les broderies plus denses, les coiffes plus hautes. Comme le note un responsable de cercle : « On ne peut pas se permettre d’être ternes. Il faut que ça claque, que ça se voie de loin. Mais en même temps, il faut que ce soit juste historiquement. C’est un équilibre difficile » (entretien, 18 août 2023).
Troisièmement, on observe des divergences entre cercles dans la manière de gérer cette tension. Certains privilégient une approche « archéologique », cherchant à reproduire aussi fidèlement que possible un costume de cérémonie du début du XXe siècle. D’autres assument une dimension créative, réinterprétant les formes anciennes avec des matériaux et des techniques contemporaines. Ces différences d’approche font l’objet de débats récurrents au sein de la fédération, et les grilles d’évaluation sont régulièrement ajustées pour tenir compte de ces sensibilités diverses.
Discussion : l’authenticité en question
Au terme de ce parcours, force est de constater que la notion d’authenticité, si souvent invoquée à propos du costume breton, est loin d’aller de soi. Notre enquête permet de dégager plusieurs résultats significatifs.
Premier résultat : l’opposition simple entre un usage quotidien « authentique » et une représentation scénique « inauthentique » ne résiste pas à l’examen historique. Comme nous l’avons vu, le costume traditionnel lui-même n’a cessé d’évoluer : il a emprunté à des sources extérieures — les modes parisiennes, les catalogues commerciaux des colporteurs lyonnais —, s’est transformé au gré des disponibilités techniques — l’arrivée du tulle, de la dentelle industrielle — et des aspirations sociales — la copie des modes bourgeoises. L’idée d’un état originel et figé du costume est un leurre, une construction rétrospective qui doit elle-même être historicisée.
Deuxième résultat : le passage à la scène introduit un changement de régime de signification. Le costume n’est plus un vêtement parmi d’autres, pris dans l’évidence du quotidien ; il devient un signe, volontairement exhibé, chargé de dire quelque chose — une appartenance, une histoire, une identité. Cette transformation, que Patrick Young analyse comme une « médiation » nouvelle, n’est ni une trahison ni une dénaturation, mais une adaptation à de nouvelles conditions d’existence du patrimoine. Les festivals, les concours, les défilés sont les nouveaux espaces où le costume fait sens, où il est regardé, évalué, célébré.
Troisième résultat : cette transformation s’accompagne de négociations constantes entre différents acteurs et différentes conceptions de l’authenticité. Pour les conservateurs de musée, l’authenticité renvoie à la matérialité des objets, à leur traçabilité, à leur conformité à des modèles historiquement documentés. Pour les responsables de cercles, elle est une exigence de fidélité au terroir, mais tempérée par les impératifs de la scène. Pour les brodeurs créateurs, elle réside dans la continuité d’un geste, d’un savoir-faire, plus que dans la reproduction littérale. Pour les jeunes danseurs, elle est vécue comme une expérience identitaire intense, indépendamment de la conformité historique objective.
Apports théoriques
Notre étude apporte plusieurs contributions aux débats théoriques sur le patrimoine et l’authenticité. D’une part, elle confirme et affine les analyses de Regina Bendix [1997] sur la construction sociale de l’authenticité. L’authenticité du costume breton n’est pas une propriété intrinsèque des objets, mais une qualité qui leur est attribuée ou contestée par des acteurs sociaux dans des contextes spécifiques. Ces attributions varient selon les positions sociales, les intérêts, les conceptions de la tradition. Le conflit entre différentes conceptions de l’authenticité est constitutif du champ patrimonial.
D’autre part, notre étude enrichit les performance studies en montrant comment la scène fonctionne comme un dispositif de reterritorialisation symbolique. Les danseurs des cercles celtiques ne se contentent pas de reproduire des danses anciennes : ils rejouent, à travers le costume, une appartenance territoriale qui n’a plus d’ancrage dans la vie quotidienne. La scène devient l’espace où cette appartenance est performée, rendue visible et tangible, à la fois pour soi-même et pour le public.
Enfin, notre étude contribue à la réflexion sur les processus de patrimonialisation en montrant leur caractère dynamique et négocié. Le patrimoine n’est pas un héritage passivement reçu, mais une construction active, constamment réinterprétée en fonction des besoins et des aspirations du présent. Les jeunes générations qui investissent aujourd’hui les cercles celtiques et les écoles de broderie en sont les acteurs principaux.
Limites et perspectives
Notre étude présente plusieurs limites qu’il convient de mentionner. D’abord, elle s’est concentrée sur quelques cercles celtiques du Finistère, principalement en pays bigouden et glazig. Une extension à d’autres terroirs — Vannetais, Trégor, Haute-Bretagne — permettrait de vérifier la généralité de nos observations. Ensuite, notre enquête de terrain, bien que prolongée, n’a pas permis de suivre dans la durée l’évolution des pratiques au sein d’un même cercle. Une étude longitudinale serait précieuse pour documenter les transformations sur le temps long.
Plusieurs perspectives de recherche s’ouvrent. La première concerne l’étude comparée avec d’autres régions françaises ou européennes connaissant des dynamiques similaires de patrimonialisation du costume — Alsace, Provence, Catalogne, Écosse. Une telle comparaison permettrait de dégager ce qui relève de spécificités bretonnes et ce qui relève de processus plus généraux.
La deuxième perspective concerne l’étude des publics. Comment les spectateurs des festivals reçoivent-ils ces costumes ? Quelles images de la Bretagne se construisent-ils à travers eux ? Une enquête par questionnaires et entretiens auprès des publics permettrait d’explorer cette dimension.
La troisième perspective concerne les usages numériques du costume. Les réseaux sociaux, les sites web des cercles, les vidéos des festivals jouent un rôle croissant dans la diffusion et la transformation de l’image du costume. Une analyse de ces médiations numériques constituerait un prolongement naturel de notre étude.
Conclusion
« On ne peut pas se baigner deux fois dans le même fleuve » : la formule d’Héraclite pourrait s’appliquer au costume breton. Ce que nous voyons sur les scènes des festivals aujourd’hui n’est pas, ne peut pas être, le même costume que celui que portaient les Bigoudènes il y a cent ans. Les conditions de sa production, de son port, de sa réception ont trop profondément changé.
Mais cette transformation n’est pas une perte. Elle est la condition même de la survie du costume comme objet culturel vivant. S’il était resté figé, reproduit à l’identique sans jamais varier, il serait devenu un fossile, une curiosité de musée sans lien avec les aspirations des générations actuelles. C’est parce qu’il a su évoluer, s’adapter, se réinventer, que le costume breton continue de parler aux jeunes Bigoudens d’aujourd’hui.
Les jeunes générations qui investissent les cercles celtiques et les écoles de broderie en sont pleinement conscientes. Leur engagement, qui leur fait parfois sacrifier leurs vacances à l’entraînement, atteste que le costume breton sur scène n’est pas un folklore désincarné, mais un support vivant d’identification et de création. Entre la fidélité aux techniques anciennes et l’innovation formelle, entre la reconnaissance des territoires d’origine et leur réinvention spectaculaire, elles inventent une authenticité de second degré — non plus celle de la reproduction à l’identique, mais celle d’une appropriation créative et d’une transmission assumée.
Le défi pour les études patrimoniales est désormais de penser cette authenticité dynamique sans la disqualifier ni la sacraliser naïvement. Le costume breton sur scène, avec ses coiffes amplifiées, ses broderies réinventées, ses territoires performés, est un objet hybride, à la fois mémoire et projet. C’est à ce titre qu’il mérite l’attention des chercheurs, des acteurs culturels et de tous ceux qui s’intéressent à la manière dont les sociétés contemporaines négocient leur rapport au passé.
Références bibliographiques
BENDIX, Regina, In Search of Authenticity: The Formation of Folklore Studies, Madison, University of Wisconsin Press, 1997.
CARIO, Hélène et Viviane HÉLIAS, Broderies en Bretagne, Spézet, Coop Breizh, 2012.
CARIO, Hélène, Fil harmonie : la Bretagne de fil en aiguille : techniques et modèles à broder, Spézet, Coop Breizh, 2019.
CRESTON, René-Yves, Le costume breton, Paris, Tchou, 1953-1961, 3 volumes.
DE SAINT JAN, Martine, « La Marmotte : coiffe de Brest », Actu.fr, 23 septembre 2015.
FALIGOT, Nolwenn, « Abécédaire de la mode bretonne », Blog de Nolwenn Faligot, 10 février 2022.
FIEGL, Amanda, « Legacy in Lace », National Geographic, octobre 2015.
GONIDEC, Jean-Pierre, Coiffes et costumes des Bretons, Spézet, Coop Breizh, 2021.
GUESDON, Yann, Coiffes de Bretagne, Spézet, Coop Breizh, 2014.
GUESDON, Yann, Le Costume breton au début du XIXe siècle, Morlaix, Skol Vreizh, 2019.
JOUANIC, Geneviève et Viviane HÉLIAS, La broderie en Basse-Bretagne, Quimper, Jos, 1996.
Le Télégramme, « La coiffe, reflet du territoire et du rang social à Tronjoly », 10 août 2007.
Le Télégramme, série « À la mode bretonne : la broderie », 24 juillet 2021.
MILLER, Daniel, Stuff, Cambridge, Polity Press, 2010.
SCHECHNER, Richard, Performance Studies: An Introduction, London, Routledge, 2002.
TURNER, Victor, From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play, New York, PAJ Publications, 1982.
VALLERIE, Erwan, Ils sont fous ces Bretons !, Spézet, Coop Breizh, 1995.
YOUNG, Patrick, « Fashioning Heritage: Regional Costume and Tourism in Brittany, 1890–1937 », Journal of Social History, vol. 42, n° 3, 2009, p. 631-656.